LE QUEBEC ET LE CANADA
 La question de la souveraineté du Québec demeure d’une brulante actualité, ravivé actuellement par les élections au Parlement fédéral du Canada qui ont lieu ce 14 octobre. Le Québec, membre fondateur de la Confédération du Canada en 1867, s’est trouvé dépossédé de la plupart de ses droits et aspirations à une «société distincte» par la création, sans son consentement, de la Fédération canadienne en 1982. Depuis lors, la lutte d’influence entre fédéralistes et souverainistes – gardons bien en mémoire que là bas les autonomistes ce sont les fédéralistes… –, n’a cessé de dominer la vie politique au Québec.
La question de la souveraineté du Québec demeure d’une brulante actualité, ravivé actuellement par les élections au Parlement fédéral du Canada qui ont lieu ce 14 octobre. Le Québec, membre fondateur de la Confédération du Canada en 1867, s’est trouvé dépossédé de la plupart de ses droits et aspirations à une «société distincte» par la création, sans son consentement, de la Fédération canadienne en 1982. Depuis lors, la lutte d’influence entre fédéralistes et souverainistes – gardons bien en mémoire que là bas les autonomistes ce sont les fédéralistes… –, n’a cessé de dominer la vie politique au Québec.
 Le droit à l’autodétermination du Québec n’existe pas stricto-sensu dans la Constitution fédérale canadienne, mais des référendum sur la souveraineté peuvent être organisé lorsque certaines conditions sont réunies. Lors des deux consultations de 1980 et 1995, la victoire du Non – de très peu, il est vrai, en 1995 – a douché les espoirs des souverainistes. Ces viscissitudes devraient rappeler aux abertzale que nous sommes que le droit à l’autodétermination n’est pas tout… encore faut-il convaincre la majorité de la population d’y adhérer !
Le droit à l’autodétermination du Québec n’existe pas stricto-sensu dans la Constitution fédérale canadienne, mais des référendum sur la souveraineté peuvent être organisé lorsque certaines conditions sont réunies. Lors des deux consultations de 1980 et 1995, la victoire du Non – de très peu, il est vrai, en 1995 – a douché les espoirs des souverainistes. Ces viscissitudes devraient rappeler aux abertzale que nous sommes que le droit à l’autodétermination n’est pas tout… encore faut-il convaincre la majorité de la population d’y adhérer !
Les deux articles que nous vous proposons ici montrent où en est aujourd’hui le débat politique au Québec. Pour resituer le contexte historique, nous vous invitons en outre à consulter les liens suivants :
http://www.chez.com/hyllas/quebec/qbcpage2.html
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/HISTfrQC_s5_Reorientations.htm
Le fédéralisme utopique d’Alain-G. Gagnon
Louis Cornellier – Le Devoir – 27 septembre 2008
Y a-t-il encore quelqu’un pour croire au renouvellement du fédéralisme canadien dans le sens des revendications du Québec ? Alors qu’une campagne électorale fédérale bat son plein et que l’occasion serait belle, pour les partis pancanadiens, de se montrer sensibles au sentiment d’aliénation nationale ressenti par une majorité de Québécois, à quoi assiste-t-on ? À un silence de moins en moins gêné à l’égard de cette question. Les libéraux et les néodémocrates font l’impasse sur cet enjeu. Les conservateurs, quant à eux, se paient de mots en croyant que cela suffira. Le Bloc québécois a beau essayer de forcer tout ce beau monde canadien à reconnaître la spécificité québécoise, cela reste en vain. Comment, dans ces conditions, et après des décennies de déceptions, y croire encore ?
Spécialiste du fédéralisme et des sociétés plurinationales, le politologue Alain-G. Gagnon persiste pourtant. Dans La Raison du plus fort. Plaidoyer pour le fédéralisme multinational, un ouvrage qui a remporté un important prix catalan, il affirme que «le fédéralisme multinational constitue une avenue opérationnelle avant-gardiste et devrait être implanté pour son potentiel réconciliateur pour les communautés qui partagent certaines valeurs, même si elles ne présentent pas le même profil culturel, politique et sociologique».
Gagnon ne s’illusionne pas sur l’état actuel du fédéralisme canadien (et, accessoirement, espagnol). Il remarque, par exemple, que même si «l’existence des nations catalane et québécoise est antérieure à la création des États espagnol et canadien», ces deux pays «ont toujours de la difficulté à reconnaître et à appuyer l’expression de la pleine personnalité politique et constitutionnelle de ces États-membres». En ce sens, son essai ne doit surtout pas être perçu comme un plaidoyer pour ces fédéralismes concrets qu’il critique avec force, mais plutôt comme un plaidoyer en faveur d’un vrai fédéralisme multinational qui reste à expérimenter dans les faits.
Deux types de fédéralisme
Il existe, précise-t-il, deux types de fédéralisme. Le premier, territorial, propose «de traiter de façon identique tous les citoyens d’un pays donné» et relève, dans une perspective démocratique, du libéralisme procédurier. Le second, multinational, «prévoit des mesures équitables permettant d’offrir aux membres de chacune des communautés nationales cohabitant au sein d’une fédération les mêmes possibilités d’accomplissement». On aura compris que, pour Gagnon, seul le second vaut puisque le premier, quoi qu’en disent ses défenseurs, revient, sous prétexte d’égalité, à imposer «la raison du plus fort», c’est-à-dire celle du groupe national majoritaire.
Le principe fédéral, pour valoir, exige quatre éléments de base : la «non-superposition des pouvoirs entre les ordres de gouvernement» ; le «respect de l’autonomie des entités politiques» et, conséquemment, «le lien de confiance entre les acteurs politiques», de même qu’une «loyauté fédérale». S’ajoute, dans les sociétés plurinationales, un enjeu fondamental : «Comment faire cohabiter, d’une part, les personnes souhaitant prioritairement l’établissement d’une citoyenneté universalisante reconnaissant à tous des droits identiques et, d’autre part, les personnes originaires des régions historiques et qui souhaitent adhérer à l’État-nation à travers cette identité communautaire ? ».
Le Canada de Trudeau, consolidé en 1982 avec le rapatriement de la Constitution, a refusé ce défi en niant radicalement la légitimité du second groupe. Au nom d’un libéralisme platement individualiste, il a mis en place les conditions pour que s’impose la raison du plus fort, au mépris de la nation québécoise — et des nations autochtones — dont le projet, selon Gagnon, est pourtant pleinement légitime puisqu’il se fonde sur des valeurs démocratiques et libérales, sur une histoire en partage et sur une citoyenneté inclusive.
Taylor et le communautarisme
Selon Charles Taylor, abondamment cité par Gagnon, Trudeau et ses suivants ont ainsi contribué «à la cause sécessionniste en tournant le dos aux principales revendications québécoises, alors qu’ils devraient faire montre d’une plus grande empathie». Pour le communautariste Taylor, en effet, il est «très important que nous soyons reconnus pour ce que nous sommes. Il est très difficile pour quiconque de maintenir un horizon de signification auquel il est possible de s’identifier si les personnes qui l’entourent rejettent cet état de choses ou n’en tiennent pas compte». L’affaire, contrairement à ce que disent les esprits las qui nous invitent à passer à autre chose, n’est donc pas insignifiante. Et cette reconnaissance, ajoute Gagnon, doit entraîner des conséquences non seulement symboliques mais effectives.
Le fédéralisme asymétrique, en reconnaissant que «les États doivent être organisés de manière à protéger la communauté» (et ses caractéristiques fondamentales, comme la langue française, au Québec), doit assumer que la meilleure manière de respecter le principe égalitaire passe par le concept d’équité. «Dans cette perspective, explique Gagnon, l’égalité entre les individus et les nations au sein d’une fédération devrait être considérée en fonction de leurs besoins particuliers et de leur développement historique, et non pas tant sur la base d’une relation identique, interchangeable avec les autres individus ou avec les autres États-membres dans une fédération». C’est seulement à cette condition, c’est-à-dire, selon Taylor, que les nations internes peuvent «exister en toute plénitude» et disposer des «institutions essentielles à leur pérennité», que «la loyauté des minorités nationales à l’égard de l’État-nation» est possible, explique Gagnon.
«Au moment où plusieurs pays en crise sur la scène internationale favorisent l’implantation des formules fédérales, conclut-il, il faut se demander pourquoi des États comme le Canada et l’Espagne en viennent à les délaisser ou à s’en méfier». Gagnon, dont les savantes analyses sont admirables de rigueur théorique, a probablement raison, mais les Canadiens anglais et leurs leaders semblent loin d’être disposés à entendre ce discours. C’est pourquoi nous aurons raison, parce que nous ne sommes pas les plus forts, de demeurer souverainistes.
Ouvrage cité : La Raison du plus fort
Plaidoyer pour le fédéralisme multinational
Alain-G. Gagnon
Québec Amérique
Montréal, 2008, 240 pages
Source : http://www.ledevoir.com/
Un fédéralisme d’ouverture ?
De la reconnaissance du Québec à celle des Québécois : retour sur la reconnaissance de la nation par le gouvernement de Stephen Harper à l’automne 2006.
Mathieu Bock-Côté – 12 juin 2007
L’émergence d’une nouvelle donne politique depuis le 26 mars dernier (2007 – NDLR) contraint le nationalisme québécois à rouvrir certaines questions qu’il considérait désuètes ou résolues. L’horizon de l’indépendance semblant pour un temps reporté, il appartient désormais aux nationalistes de scruter la réalité canadienne dans laquelle le Québec s’inscrit pour bien voir comment y préserver ses intérêts vitaux et son identité, en portant une attention particulière à la métamorphose supposée du fédéralisme et des repères traditionnels à partir desquels on reconnaissait habituellement la relation Canada-Québec.
Car on parle beaucoup de fédéralisme d’ouverture ces jours-ci. Dans la capitale fédérale, le gouvernement conservateur, décidé à décentraliser sa pratique du fédéralisme et disposé à certains «accommodements raisonnables» envers le Québec, se présente de plus en plus comme l’allié naturel d’un nationalisme québécois dont il célèbre à la fois la pertinence et les limites. Après l’ouverture fédérale sur le dossier de l’Unesco puis la reconnaissance du Québec comme nation, le gouvernement de Stephen Harper a récemment entrepris la résolution du déséquilibre fiscal. Cette ouverture aura été d’autant mieux accueillie par l’électorat francophone qu’elle aura succédé au fédéralisme centralisateur et jacobin qu’a pratiqué le Parti libéral du Canada dans la dynamique post-référendaire (1995 – NDLR), qui offrait comme seule réponse au malaise québécois une thérapie de choc dont l’objectif était la canadianisation forcée de l’espace politique québécois.
Mais pour peu qu’on fasse le pari d’aller au-delà des apparences, on avouera vite notre scepticisme. Non que les gestes du gouvernement soient systématiquement nuisibles envers la différence québécoise. Mais soutenir que leur conjugaison mènerait à la résolution de la question nationale serait une erreur dramatique, que semblent commettre ceux qui confondent une ouverture circonstancielle et électorale à la réalité québécoise et un désir de réaménager les institutions fédérales canadiennes pour les adapter durablement à la morphologie dualiste du pays.
En fait, il faut revenir sur le contexte canadien du dernier quart de siècle pour bien comprendre la portée de ce fédéralisme d’ouverture. On ne le rappellera jamais assez : c’est pour en finir avec le nationalisme québécois et l’identité qu’il exprimait que Pierre Eliott Trudeau a mis en place une nouvelle constitution (1982 – NDLR) cristallisant dans un ensemble institutionnel hermétique et achevé une nouvelle identité pancanadienne, formalisant pour de bon l’idéal du Canada one nation, flottant dans la conscience historique canadienne-anglaise depuis les origines de la confédération. Contre ce Canada qu’ils savaient incompatible avec leurs intérêts vitaux, plusieurs nationalistes auront mené une dernière lutte au moment de Meech, au nom de la vision québécoise de la fédération. Sans succès, comme on le sait.
Car le Canada historique, avec ses deux peuples fondateurs, est pour de bon enterré sous une nouvelle constitution conjuguant l’égalité des provinces avec la célébration tous azimuts d’un multiculturalisme parfaitement compatible avec la souveraineté canadienne. C’est d’ailleurs en conformité avec cette doctrine qu’on se sera ouvert à la différence québécoise. La reconnaissance de la nation québécoise (et non du Québec, faut-il le rappeler, ce qui n’est pas qu’une différence sémantique) [vote de la Chambre des Communes du Canada, le 27 novembre 2006, NDLR ] n’entrait aucunement en contradiction avec l’égalité des provinces comme l’ont rappelé les principaux représentants de l’actuel gouvernement, pour qui elle ne générait aucun nouveau pouvoir et aucun statut particulier, sur le plan constitutionnel et légal. Pour dire vrai, c’est dans une perspective multiculturelle que le gouvernement canadien a reconnu l’identité québécoise en ne lui accrochant aucune conséquence politique et en refusant de fonder à partir d’elle un pouvoir différencié. La reconnaissance de la nation québécoise ajoute peut-être une touche de bleu à la mosaïque identitaire canadienne, elle ne change en rien l’équilibre des pouvoirs dans la fédération et n’ouvrira aucunement une «constitution scellée pour un millénaire», comme aimait dire Trudeau. Ce pour quoi on dira de cette reconnaissance de la nation québécoise qu’elle neutralise la question nationale en la dépolitisant et qu’elle représente pratiquement une poursuite du trudeauisme par d’autres moyens.
C’est à l’intérieur du fédéralisme post-1982 qu’on propose actuellement des concessions au Québec. Le pouvoir fédéral cherche ainsi à résoudre la question nationale québécoise dans un cadre constitutionnel construit pour la disloquer, en intégrant le Québec à l’ensemble canadien pour un peu de monnaie symbolique ou pour quelques réaménagements administratifs et financiers qui n’ont aucune conséquence durable sur la distribution du pouvoir politique réel au Canada. De ce point de vue, la récente diminution du poids politique à la Chambre des communes est exemplaire : l’ouverture rhétorique au Québec n’aura eu aucun effet institutionnel au moment de calculer la place de chacun dans l’ensemble fédéral. Dans les faits, le fédéralisme d’ouverture en est un de compensation symbolique pour une nation dont on dit presque le nom mais qu’on traite dans les faits comme une province parmi d’autres. On conviendra de l’aspect hasardeux de la manœuvre, pour peu qu’on la considère d’un point de vue québécois. Ceux qui cherchent à acclimater le nationalisme québécois à un nouveau contexte canadien qu’ils croient fructueux pour de nouvelles avancées collectives auraient donc tout avantage à relativiser leur enthousiasme en se rappelant bien qu’une pratique plus flexible et accommodante du fédéralisme, tel qu’il s’est refondu en 1982, ne change en rien la permanence d’une constitution structurellement planifiée pour marginaliser le fait québécois dans sa prétention à constituer durablement un espace politique autonome.
Le nationalisme québécois, qu’il travaille à l’avènement de l’indépendance ou à quelconque reconnaissance dans une ambition de moindre envergure, aurait tout avantage à scruter le Canada tel qu’il s’est métamorphosé en un quart de siècle. Il n’est pas dit que le nationalisme québécois ne puisse faire quelques gains accessoires dans les circonstances actuelles. Mais il est illusoire d’espérer ranimer le Canada historique à partir duquel le Québec s’est construit une vision propre de la fédération. Et plus illusoire encore de capitaliser sur la reconnaissance actuelle pour la convertir en pouvoir politique dans une refonte dualiste du fédéralisme dont personne ne parle sérieusement. Ainsi apparaît-il indispensable de fournir, surtout dans le contexte actuel, une définition forte des intérêts vitaux du Québec, pour éviter leur dissolution dans un amincissement de la question nationale qui aurait comme conséquence finale un appauvrissement dramatique de l’identité québécoise avec une perte de pouvoir collectif probablement irrécupérable.
L’auteur : Mathieu Bock-Côté est directeur de recherche à l’Institut de Recherche sur le Québec et candidat au doctorat en sociologie à Université du Québec à Montréal ;
Site internet : www.bock-cote.net/
Source : Institut de Recherche sur le Québec – www.irq.qc.ca
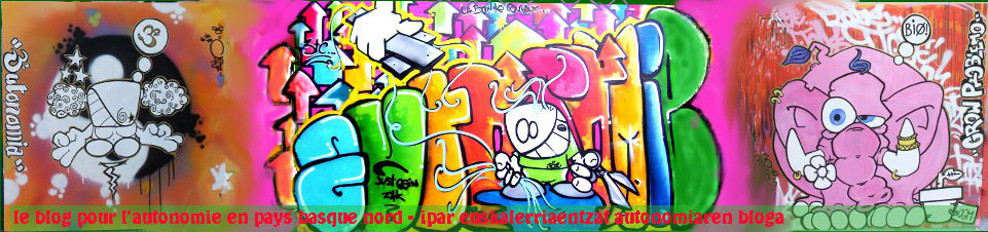
Laissez un commentaire