Pour une autonomie réelle dans un fédéralisme abouti
Voici la seconde partie des réflexions d’Allande Socarros, au sujet des événements de Catalogne. Il y aborde des distinguos subtils, qui pourraient être définis en des termes aussi inhabituels dans l’esprit des gens, telle « la pleine autonomie » ou « l’indépendance ». « L’indépendance » non assujettie à une « pleine autonomie », pouvant ressembler à une véritable sujétion, surtout à une époque où les entités étatique sont soumis à des alliances militaires ou économiques, dans lesquelles une notion de supra nationalité peut l’emporter au niveau des décisions économiques, donc sociales ou militaires. Cette supra nationalité étant bien souvent une soumission aux intérêts d’un État prépondérant (les États Nations luttant conte l’émergence de nouvelles entités, bien souvent antérieures à leur existence, et ne disposant plus de leur « pleine autonomie »).
Pour une autonomie réelle dans un fédéralisme abouti
 Le bras de fer engagé entre le pouvoir autonome catalan dirigé par une majorité pro-indépendance et le gouvernement espagnol aux mains du Partido Popular de Mariano Rajoy n’a pas vraiment mis l’accent – du moins dans les milieux médiatiques et celui des commentateurs politiques – sur la question du droit à l’autodétermination. Cela montre combien la réflexion sur ce sujet de fond est escamoté par le déferlement sur la place publique des termes comme « autonomie » ou « indépendance », plus rarement « souveraineté », qui sont de surcroît allègrement pris pour synonymes et « vendus » tels que à une opinion publique peu au fait des ces choses là… Or, il y a évidemment bien des différences entre ces concepts, tout au moins si on les étudie d’un point de vue juridico-institutionnel.
Le bras de fer engagé entre le pouvoir autonome catalan dirigé par une majorité pro-indépendance et le gouvernement espagnol aux mains du Partido Popular de Mariano Rajoy n’a pas vraiment mis l’accent – du moins dans les milieux médiatiques et celui des commentateurs politiques – sur la question du droit à l’autodétermination. Cela montre combien la réflexion sur ce sujet de fond est escamoté par le déferlement sur la place publique des termes comme « autonomie » ou « indépendance », plus rarement « souveraineté », qui sont de surcroît allègrement pris pour synonymes et « vendus » tels que à une opinion publique peu au fait des ces choses là… Or, il y a évidemment bien des différences entre ces concepts, tout au moins si on les étudie d’un point de vue juridico-institutionnel.Par ailleurs, l’écho médiatique suscité par le succès électoral des forces du mouvement national corse n’a pas non plus contribué à clarifier le tableau… surtout si on se réfère seulement à la grille de lecture des médias français. La quasi-totalité de ces organes de presse baigne dans le « roman national » de la « France une et indivisible », du « pays des lumières », quand ce n’est pas dans la fadaise de « la Patrie des droits de l’homme » et, par conséquent, leur champ d’analyse ne conçoit absolument pas que les réalités puissent être autres. Concernant la Corse, il faut toutefois dire, à la décharge des médias français en cause, que l’union électorale victorieuse de ‘Pe a Corsica’ (Pour la Corse) ne leur a pas facilité la compréhension, puisque cette alliance regroupait des « autonomistes » et des « indépendantistes ». Moi-même, j’avoue que j’ai du mal à comprendre comment des autonomistes corses ne seraient pas ipso facto des partisans de l’indépendance et comment les indépendantistes pourraient imaginer atteindre une pleine souveraineté sans passer par l’étape de l’autonomie.
Quoi qu’il en soit, la France des journalistes et commentateurs politiques, des spécialistes auto-proclamé des « nationalismes » – parmi lesquels il n’incluent pas, bien entendu, le nationalisme français jacobin -, des patriotes franchouillards de clavier qui sévissent sur les réseaux sociaux a agité le spectre du « séparatisme » corse parvenu aux rênes du pouvoir sur sa terre d’élection… Et de se répandre en les habituelles formules caricaturales, telles que « repli sur soi » ou encore « risque de balkanisation de l’Europe ». Des exégètes qui jamais au grand jamais ne remettront en question le pourquoi de la souveraineté dont bénéficient des micro-États membres de l’Union européenne, comme le Luxembourg ou Malte ou de pays à population réduite comme les Pays Baltes. Dans leur esprit, c’est un état de fait établi, qui n’a cependant pas vocation à se reproduire, tout au moins dans l’espace communautaire européen. On en revient à ce grand classique de la mauvaise foi des dirigeants, du personnel politique, de la coterie médiatique, de la camarilla des « experts », et de la masse ignorante de la population des États-nations : le raisonnement à géométrie variable dont l’axiome majeur est « ce qui peut être vrai là-bas ne l’est pas ici »… L’histoire souvent leur a donné tort, mais ils s’enferrent dans leur déni… en disciples d’un nationalisme français fondé sur la mise sous tutelle de pays et de populations, sur l’expansionnisme territorial par agression guerrière, ruse ou forfaiture, sur la colonisation d’hier et le néo-colonialisme d’aujourd’hui, sur une prétention à l’universalisme…
L’arrivée au pouvoir n’est pas un blanc-seing !
Les événements en Catalogne péninsulaire et en Corse ont apporté aussi leur lot d’approximations, d’emballements ou de conclusions hâtives dans le monde abertzale en Pays Basque (nord et sud). Les succès électoraux de forces politiques portant des aspirations de recouvrement des droits nationaux ont conduits à quelques extrapolations hasardeuses ou pour le moins prématurées. Le fait que des mouvements autonomistes, indépendantistes, souverainistes parviennent, dans un contexte de subordination à un État tutélaire, à la direction des affaires d’une entité territoriale ne garantie en rien un non retour en arrière et encore moins une progression ininterrompue vers le plein recouvrement des droits nationaux.
Il est pourtant une erreur d’appréciation assez largement répandu dans les sphères autonomistes/indépendantistes : celle d’imaginer qu’une fois parvenus au pouvoir après avoir remporté les élections aux institutions autonomes, c’est quasiment la voie ouverte vers l’indépendance. On rentre là dans les registres du chimérique, de la précipitation, et, à tout le moins, de l’irréflexion. Car c’est pure illusion d’imaginer qu’une majorité de la population votant pour les forces autonomistes/indépendantistes devient de facto pro-indépendance. C’est faire abstraction de toute la profondeur d’une colonisation des esprits, façonnée par des décennies voire des siècles de tutelle. Une majorité électorale amenant au pouvoir des forces, mouvements ou coalitions politiques en faveur de l’émancipation nationale n’est pas obligatoirement acquise dans les mêmes proportions à l’indépendance. Entre les deux attitudes, il y a toute la marge entre la confiance en une capacité de gérer une entité autonome et l’appréhension du saut dans l’inconnu. Et évidemment, le pouvoir tutélaire a la partie facile pour jouer sans scrupules sur les peurs et pour les accentuer par des affirmations péremptoires et retorses, du genre : (…) et avec l’indépendance, comment vont-ils pouvoir payer les retraites ? ou encore (…) de quelle façon pourront-ils financer les systèmes de protection sociale ?. Ce sont là des arguments biaisés, mais qui risquent d’avoir une impact sur les populations. Ainsi, les référendums portant sur la proposition de souveraineté au Québec en mai 1980 et en octobre 1995 ainsi que celui sur l’indépendance de l’Écosse en septembre 2014 se sont soldés par autant d’échecs, dûs, pour une part, à une inquiétude devant un avenir à construire de son propre chef.
En conséquence, le premier des combats pour les peuples, populations ou communautés répondant à des critères bien précis (historiques, culturels, territoriaux…) – et évidemment pas pour des entités comme des municipalités ou des micro-régions comme des affirmations caricaturales et apocalyptiques voudraient le faire accroire ! – c’est de parvenir à faire reconnaitre de manière irréversible le droit à l’autodétermination. La question de l’application supposera, elle, non seulement une maturation des consciences dans les populations concernées, mais aussi l’élaboration et la popularisation d’un projet émancipateur et prometteur d’un mieux par les forces patriotes.
Le droit à l’autodétermination : un apanage non contestable
L’aspiration à pouvoir faire des choix, à conduire une politique adaptée à un territoire et à ses habitants, à imaginer et à maitriser son devenir peut s’appeler « indépendance » ou « souveraineté », mais elle peut aussi se concevoir à travers une autonomie réelle dans le cadre d’un ensemble fédéral abouti. La formule « autonomie réelle » est dans mon esprit celle qui se concrétise dans une entité qui dispose, outre des compétences de gestion classique, de la faculté législative (à faire la loi, donc) mais aussi du pouvoir réglementaire, et de la maitrise fiscale. Une autonomie qui ne possède pas ces deux caractéristiques – les capacités législatives et réglementaires et la compétence fiscale – est un auto gouvernement à vocation gestionnaire qui reste sous l’emprise d’un État tutélaire pour ce qui est de ces deux domaines fondamentaux.
À l’évidence, une autonomie réelle parait inconcevable dans l’ensemble français qui s’est bâti dans une optique exactement inverse, à savoir celle d’un État unitaire, centralisé à outrance, ne reconnaissant pas les droits collectifs d’une communauté donnée, érigeant en dogme l’unité, confondant union et uniformité. Il fallait à la France ce genre de mythes fondateurs pour justifier une construction réalisée via les conquêtes militaires, la contrainte, la soumission de pays et de populations. Et la République de type jacobine a poussé encore plus loin que les régimes monarchiques cette conception d’État-nation intégrateur à prétention universaliste.
Une autonomie réelle dans l’ensemble français relève par conséquent de l’impossible, sauf à ce que l’appareil d’État, la formation des élites politiques, les mentalités sociétales façonnées par des siècles d’éducation fondée sur le roman national, change du tout au tout… ce qui est pour le moins improbable ! Une autonomie pleine et entière ne peut ainsi se concevoir que dans une ensemble européen réinventé sur un modèle fédéral abouti. J’entend par « modèle fédéral abouti » un fédéralisme qui ne se fonde pas sur des État-nations, mais sur des entités historiques, géographiques, territoriales qui se fédèrent librement et mettent en commun ce qu’il est pertinent de mener de concert.
Malgré le fait que l’Union européenne en soit resté à une confédération d’États-nations agglomérés autour d’un marché commun, et qui, de ce fait, n’a pas su dépasser les intérêts nationaux égoïstes des uns et des autres, des politiques d’intégration dessinées à l’échelle fédérale et déclinées à l’échelon fédéré seront bien évidemment parties intégrantes d’une articulation autonomies réelles/fédéralisme abouti. En effet, dans les domaines économiques, sociaux, sociétaux, des orientations, des dispositifs, des mécanismes seront à élaborer de manière concerté, mais avec l’ambition de toujours tout tirer vers le haut : l’harmonisation fiscale, la réglementation sociale, le souci environnemental, les questions migratoires et d’accueil, la coopération internationale… Pour ce qui est de la politique économique concertée, la mondialisation capitaliste ne laisse pas beaucoup de marges de manœuvre, mais une autonomie réelle devra promouvoir une économie de type circulaire, avec des circuits courts et le soutien à une agriculture paysanne.
Une charte des valeurs fondamentales
Un ensemble fédéral abouti conçoit que les entités fédérées qui le souhaitent disposent de manière inaliénable et inconditionnelle du droit à l’autodétermination, donc de la possibilité de quitter, si tel est leur souhait, l’entité fédérale. Une organisation fédérale qui ne reconnaitrait pas le droit à l’autodétermination d’entités autonomes librement associées ne peut pas s’articuler avec un autonomie réelle. Le droit à l’autodétermination est un apanage inaliénable d’une autonomie réelle.
La conception « classique » d’un système fédéral, tel en tous cas qu’il fonctionne dans bien des endroits du monde, c’est que seuls trois domaines relèvent de la fédération : la monnaie, la défense et la diplomatie. Cette configuration, qui peut certes paraître enviable lorsque l’on se trouve enserré dans une ensemble aussi corseté que l’État français, n’est cependant pas en phase avec un modèle fédéral abouti, qui pourrait être une alternative à une indépendance basée sur la création d’un État. En raisonnant à l’échelle européenne, la question de la monnaie ne devrait pas poser de problème : l’Euro existe déjà, même s’il y aurait bien des changements à apporter à son fonctionnement chaotique dû aux intérêts divergents et en compétition des États-nations actuels et aussi à une soumission à une économie financiarisée. En ce qui concerne la défense, les menaces contemporaines, dont les politiques du monde occidental sont en bonne partie responsables – pillage économique de pays dit du Tiers-Monde, déploiement de contingents militaires destinés dans la réalité à garantir la pérennité d’intérêts économiques, soutien à des régimes autocratiques ou dictatoriaux garants de ces mêmes intérêts -, ces menaces donc peuvent « justifier » l’existence de forces armées à une échelle fédérale. Néanmoins, dans une configuration d’autonomies réelles fonctionnant dans un système de fédéralisme abouti, les entités autonomes devraient avoir toute latitude d’adhérer ou non à une politique de défense commune. Ce serait là un choix qui ne pourrait leur être contesté, aussi bien que la possibilité de se retirer en cas de participation décidée antérieurement. La politique des relations extérieures, pour sa part, pourrait se concevoir à deux niveaux : celui de l’entité autonome et celui de l’ensemble fédéral. L’essentiel étant que les deux niveaux ne se télescopent pas et n’entrent pas en contradiction majeure ou en compétition malencontreuse. Car une entité d’autonomie devrait avoir la possibilité d’établir les relations et les coopérations qui lui paraissent les plus opportunes pour son propre compte. L’impératif étant ici que les choix de relations extérieures d’une entité fédéré (d’une autonomie) ne contreviennent pas à une charte des valeurs fondamentales portée à la fois par les entités fédérées et par l’ensemble fédéral.
Cette charte des valeurs fondamentales communes intégrera, bien évidemment, l’adhésion aux libertés essentielles et le respect scrupuleux de celles-ci : liberté d’expression, d’association, d’information, de réunion, de conscience, de contestation, de croyance religieuse ou de non-croyance… Elle devra intégrer aussi les avancées civilisatrices des décennies ou siècles écoulés : l’abolition de la peine de mort, l’interdiction absolue des pratiques de tortures, le droit à une éducation émancipatrice, le droit à la contraception et à l’avortement, l’égalité de droits entre les femmes et les hommes, l’accès au travail, le droit à un logement digne… Cet ensemble de valeurs sera un socle à respecter en totalité et de manière impérieuse par les entités autonomes comme par l’ensemble fédéral.
Et l’indépendance dans tout ça ?
On pourra évidemment m’objecter que tout ce que je développe ici relève du chimérique, de l’invraisemblable, de l’irréalisable dans un environnement d’États-nations établis depuis belle lurette et avec des organismes internationaux qui en sont essentiellement les émanations. Mais outre le fait que ce qui paraissait impossible naguère s’est réalisé (pas toujours dans les meilleures conditions, certes !) – les processus de décolonisation, l’éclatement de l’Union soviétique, les indépendances des pays formant antérieurement la Yougoslavie… – la qualification d’illusoire peut tout aussi bien s’appliquer à l’aspiration à l’indépendance de nations sans États dans le contexte de l’ensemble européen et particulièrement de l’UE.
Pour un abertzale – et j’en suis un – l’aspiration à l’indépendance, à la souveraineté (encore que ces deux concepts peuvent être différents, par exemple pour des pays ayant obtenu leur indépendance formelle d’une puissance coloniale, mais dont la souveraineté réelle par rapport à l’ancienne tutelle est toute relative…) est bien sûr un dessein exaltant, une ligne de conduite, un aboutissement. Il faudrait cependant réfléchir à ce que peut apporter à un pays sous tutelle et à sa population une indépendance, dotée de tous les attributs de souveraineté possibles. Quel est en effet le sens de cette aspiration, de cet idéal à une époque où des espaces de coopération supra-étatiques sont en place, où l’indépendance économique (ressources, sources d’énergie, technicité…) n’est l’attribut que de quelques rares pays, où les échanges mondialisés ont imposé un certain nombre de normes ?
Mais au delà même de ces questions sur lesquelles il conviendrait de se pencher, l’indépendance supposerait la création d’une entité étatique. Or si l’on prend les cas de l’Écosse, de la Catalogne, de la Corse ou du Pays Basque, dans quelle configuration supranationale se placerait ces entités ayant accédé à l’indépendance ? À priori, elle devraient prendre leur place dans une ensemble européen constitué par des États-nations, en d’autres termes une confédération d’États-nations, telle que l’est aujourd’hui l’Union européen
ne. La création d’un État a donc pour corollaire la pérennisation d’une Europe des États-nations. Est-ce vraiment une panacée, sachant qu’une configuration étatique et ses prolongements à une échelle plus large qu’un pays ont fait montre de bien des travers, dévoyant le fonctionnement démocratique des institutions, s’éloignant des réalités quotidiennes d’une majorité de citoyens, donnant lieu à une administration souvent omnipotente, instituant une « classe politique » ou bien encore une technocratie fréquemment en déphasage avec les populations.
Réfléchir à ce que signifie de nos jours l’indépendance ne signifie pas renoncer à une telle perspective. Je crains fort néanmoins que dans le monde abertzale d’aujourd’hui, aussi bien en Pays Basque nord qu’en Pays Basque sud, exprimer une intention comme celle-là ne soit ressentie de manière épidermique et compris comme un renoncement. Ce n’est pourtant qu’une impérieuse nécessité, celle de sortir d’une pensée en jachère pour imaginer les champs du possible et pour y semer les graines d’un avenir le meilleur possible pour le Pays Basque, comme pour tous les autres pays niés dans leurs existences politiques pleines et entières et privés de leurs droits nationaux.
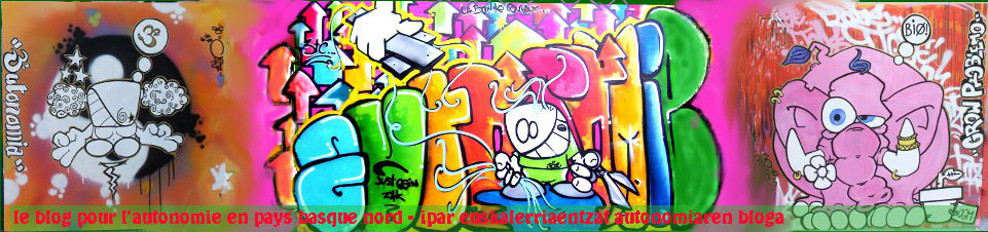
Laissez un commentaire