LE JOUR DE LA MATRIE
 Mon premier Aberri Eguna, je l’ai célébré par surprise, disons. C’était en 1971, je pense, le jour de Pâques, évidemment. A St Jean de Luz. Je sortais de la grand-messe avec ma mère, lui tenant la main, bien sagement, comme un gentil petit garçon qui croit encore que le Monde est à sauver, quand soudain, la foule fit barrage entre mes rêveries rédemptionnelles et la pâtisserie Etchart, de l’autre côté de la rue Gambetta. Des femmes criaient, les bigotes ful- minaient, des hommes scandaient, les bigots fustigeaient tandis que deux drapeaux se défiaient en un singulier duel au milieu de la fumée des lacrymogènes. A l’instar de mon estomac, mon cœur empli des seules bonnes et belles intentions pascales devait très certainement battre la chamade tandis que maman me broyait le métacarpe pour m’arracher à ce spectacle d’apocalypse natio- naliste. Très certainement. Ma mémoire n’embellit rien, c’est à peine si je donne un peu de contraste à mes souvenirs d’enfant pour y découvrir les mots d’une genèse personnelle… Amatto ne pouvait décemment m’expliquer que des Basques se battaient contre des Français (c’était en fait plutôt le contraire, l’agresseur s’étant avéré être un ultra nationaliste français membre éminent du SAC, étendard sanglant levé à bouts de bras vengeurs, char- geant le groupe de patriotes basques afin d’abreuver les sillons sous les pavés à deux pas de la plage), tout en m’entraînant fermement vers le chemin salvateur de notre maison, elle prétendit, en guise de justification pour notre fuite (je n’aurais dû alors n’avoir aucune raison de douter de sa parole) que c’était des Espagnols (plus de 35 ans après, j’hésite encore à utiliser une majuscule) qui étaient venus tout exprès foutre la merde au Pays basque, en France, au Pays basque-français, quoi…
Mon premier Aberri Eguna, je l’ai célébré par surprise, disons. C’était en 1971, je pense, le jour de Pâques, évidemment. A St Jean de Luz. Je sortais de la grand-messe avec ma mère, lui tenant la main, bien sagement, comme un gentil petit garçon qui croit encore que le Monde est à sauver, quand soudain, la foule fit barrage entre mes rêveries rédemptionnelles et la pâtisserie Etchart, de l’autre côté de la rue Gambetta. Des femmes criaient, les bigotes ful- minaient, des hommes scandaient, les bigots fustigeaient tandis que deux drapeaux se défiaient en un singulier duel au milieu de la fumée des lacrymogènes. A l’instar de mon estomac, mon cœur empli des seules bonnes et belles intentions pascales devait très certainement battre la chamade tandis que maman me broyait le métacarpe pour m’arracher à ce spectacle d’apocalypse natio- naliste. Très certainement. Ma mémoire n’embellit rien, c’est à peine si je donne un peu de contraste à mes souvenirs d’enfant pour y découvrir les mots d’une genèse personnelle… Amatto ne pouvait décemment m’expliquer que des Basques se battaient contre des Français (c’était en fait plutôt le contraire, l’agresseur s’étant avéré être un ultra nationaliste français membre éminent du SAC, étendard sanglant levé à bouts de bras vengeurs, char- geant le groupe de patriotes basques afin d’abreuver les sillons sous les pavés à deux pas de la plage), tout en m’entraînant fermement vers le chemin salvateur de notre maison, elle prétendit, en guise de justification pour notre fuite (je n’aurais dû alors n’avoir aucune raison de douter de sa parole) que c’était des Espagnols (plus de 35 ans après, j’hésite encore à utiliser une majuscule) qui étaient venus tout exprès foutre la merde au Pays basque, en France, au Pays basque-français, quoi…
Seule une colère carrément biblique pouvait excuser chez ma mère l’utilisation d’un vocabulaire si sulfureux. Quoique très catholiques, dans notre famille nous succombions parfois à un ou autre péché capital, particulièrement les dimanches, Satan et Belzébuth en étant les exclusifs inspirateurs avec Lucifer, le démon spécialiste de l’orgueil. Ce jour-là, j’appris à maîtriser mes dons de Dieu pour ne pas fâcher davantage ma sainte génitrice. Ma colère à moi serait pour plus tard. Juste un peu plus tard. Je ne lui répliquai surtout pas que, si les manifestants brandissaient des drapeaux basques (j’ignorais encore son doux nom d’ikurriña), ils ne pouvaient être des espagnols (je craque, désolé)… et puis je ne lui avouai pas non plus que j’avais bien reconnu qu’ils s’exprimaient dans la même langue que quand elle s’engueulait avec papa (pour ne pas que je comprenne), la même langue basque que je chantais phonétiquement avec tant de cœur et de passion à l’église pa- roissiale. Moi je n’étais pas espagnol, je venais ainsi de prendre conscience de ma basquitude, malgré ma frustration de la langue ancestrale, comme les enbata zikiñak j’étais d’ici, de St Jean de Luz, du Pays basque, tout simplement, tout naturellement j’avais choisi ce jour-là le camp des différents, des minorisés, des vilipendés, j’avais choisi secrètement d’être Basque. Basque et c’est tout.
Mon deuxième Aberri Eguna, en fait, fut un acte manqué. C’était en 1978, l’année Orreaga… et je n’avais trouvé personne pour m’y accompagner. Aberri Eguna à La Rhune, pas à Orreaga. (Le rendez-vous de la célébration des 1200 ans de la bataille de Roncevaux serait pour le 15 août, et je le manquerais aussi.) Je dois reconnaître que cela aurait été pour le moins très compliqué et encore plus risqué pour moi que de participer à cette fête bucolique et revendicative, mythique mi-raison, de la Patrie, que dis-je, de la Matrie des Basques en ce jour de Pâques 1978. Déserter l’abri anti-atomique et la garde de ces majestueux bombardiers nuclé- aires Mirage IV, fleuron internationalement envié de l’aviation française, tourner le dos au Mur de Berlin, franchir nuitamment et furtivement ceux de ma caserne, traverser à pied et en stop (la Jument bleue n’était encore qu’une inaccessible étoile à deux roues dont je ne pouvais même pas rêver la selle) les Landes des Gas- cons hostiles, et surtout trouver des complices à mon évasion et enfin affronter le soi-disant pragmatisme maternel anti-espagnol : «Non maman, ton fils n’est ni français ni espagnol, il est Basque !… et il a accompli pitoyablement son service militaire pour l’Etat français.»
Mon troisième Aberri Eguna fut le premier auquel je participai en réalité. Politiquement un peu, physiquement beaucoup, spirituel- lement avec passion, et sentimentalement à la folie. C’était un an plus tard, en 1979, à Mauléon, en Soule, 7ème plus petite province de l’Euskadi d’alors, Pays de Cocagne pour les abertzale (pa- triotes), les purs, les socialistes et indépendantistes, les vrais, qui n’existerait évidemment que dans l’Askatasuna (Liberté) au son de l’hymne des combattants (eusko gudariak) entonné en canon par une joyeuse bande de copains, réunis à l’apéro du café de l’Europe, rue du Jeu de Paume. Et puis il y eut, pour moi et les miens, ceux de ma génération, de plus en plus nombreux, un quatrième, et un cinquième, et un sixième… et un dixième Aberri Eguna. Très vite. La jeunesse ne sait que s’enfuir… ou mourir assassinée. St Palais, Cambo, Biarritz, Hasparren, Ustaritz, Ascain, Itxassou… villes et villages qui s’égrainent sur ce si joli blog tout bleu de ma mémoire collectivisée, comme autant d’étapes d’un jour pour toujours à ma prise de conscience politique. Pour moi et pour des centaines de jeunes comme moi en Pays basque nord, l’Aberri Eguna a toujours été synonyme de «jour de lutte». Les bigotes et les bigots, toutes les bonnes âmes à tiroir caisse pouvaient bien nous traiter de «fouteurs de merde», et même bien pire, c’est nous qui avions raison. L’histoire finira bien un jour par le prouver… Ma mère ne m’emprisonnait plus la main ni la tête depuis bien longtemps, heureusement. Je pouvais réclamer partout l’indépendance d’une nation sans Etat, bouter tous les Gaulois en Gaule, me battre idéologiquement contre la France et l’Espagne coalisées, guerroyer à un contre vingt, alors que, instinctivement, déjà, je comprenais que nous avions seulement besoin d’une patrie à notre taille, une petite patrie pour les Basques. Nous nous entredéchirions juste pour lui inventer un nom qui sonne le glas du vieux monde et laisse toute la place nécessaire à l’épanouissement de nos petites différences. Il en faut des années pour apprendre l’autonomie et tous ses sacrifices ! A vingt ans, en y hurlant ma passion de la vie, j’ai sacrifié ma voix de stentor dans toutes les rues d’Iparralde, quitte à la mettre sans cesse en danger, la vie, ma vie, pas la passion, jamais la passion, jamais ma passion ne devrait s’apaiser. Même si les engagements, parfois, les luttes semblent s’essouffler, s’enrouer, s’étouffer presque au détour d’une énième défaite, d’un énième drame humain ou d’une énième désillusion, la passion rebondira parce qu’il ne peut en être autrement : Herriak bizi behar du, le pays, mon pays, mon peuple doit exister, et c’est tout.
Presque trois décennies plus tard, je ne tiens plus le compte des Aberri Eguna auxquels j’ai participé plus ou moins activement, ni de ceux que j’ai boycotté pour une raison ou pour une autre. Je ne veux pas parler ici des stratégies antagoniques et des désaccords plus ou moins fondamentaux. Je ne veux pas ressasser les vieilles rancoeurs encore vivaces. Je ne veux plus rester sur le bord de la route à regarder les «espagnols» se battre pour moi et pour ma liberté…
Peut-être ai-je enfin atteint l’âge de la véritable autonomie ?!
Mes parents sont morts tous les deux et le cordon ombilical aujourd’hui minéralisé. Des dizaines d’amis, de camarades, de compagnons, des centaines et des milliers de sans-noms ont été avalés mais la lutte pour la petite patrie maintiendra malgré tout le peuple basque en vie et je veux continuer d’en témoigner, sur ce blog et ailleurs. Ce dimanche encore, à l’Aberri Eguna, sur le pont Saint Jacques, c’était comme si j’avais pris rendez-vous avec l’histoire. J’ai frémi de bonheur et de passion en serrant la main de Mamour devant cet ikurriña géant. Un immense drapeau pour un tout petit pays. Un petit pays pour les Basques, un grand pas pour l’humanité… et c’est tout.
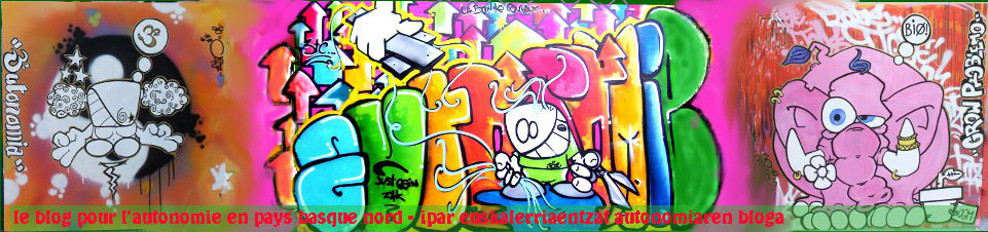
 Acteurs et actrices de la lutte abertzale en Pays basque nord, nous sommes de ceux et celles qui se sont engagés dans tous les secteurs de la vie publique tant sur les domaines politiques, qu’économiques, sociaux et culturels avec la volonté d’oeuvrer pour que vive notre peuple. De ceux et celles qui, en Pays basque nord, lancent des initiatives et mettent en place les moyens pour poser les jalons de la prise en main de la vie de notre pays. L’acte politique que nous posons aujourd’hui s’inscrit également dans cette démarche…
Acteurs et actrices de la lutte abertzale en Pays basque nord, nous sommes de ceux et celles qui se sont engagés dans tous les secteurs de la vie publique tant sur les domaines politiques, qu’économiques, sociaux et culturels avec la volonté d’oeuvrer pour que vive notre peuple. De ceux et celles qui, en Pays basque nord, lancent des initiatives et mettent en place les moyens pour poser les jalons de la prise en main de la vie de notre pays. L’acte politique que nous posons aujourd’hui s’inscrit également dans cette démarche…